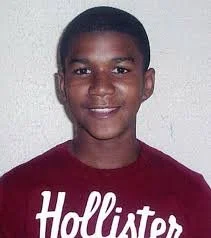Adultification : Quand la société nie l’enfance noire
6 octobre 2025, une vidéo circule : l’humoriste Nawell Madani aurait frappé un enfant noir de six ans sur les Champs-Élysées.
Elle dit avoir cru qu’il voulait lui voler son sac.
Le père, créateur de contenu, filme la scène : et Internet s’enflamme.
Mais au-delà du choc et des débats qui s’opposent, cette scène révèle quelque chose de plus profond, de plus systémique : la façon dont notre société perçoit les enfants noirs. Car ce réflexe — voir une menace là où il y a un enfant — n’est pas nouveau : il s’appelle le biais d’adultification.
Ce biais, largement documenté par des chercheuses comme Jamilia J. Blake, désigne la tendance à percevoir les enfants noirs comme plus âgés, plus conscients, moins innocents et moins dignes de protection que les enfants blancs. Un mécanisme qui efface l’enfance, altère le regard des adultes, et ouvre la voie à des violences banalisées.
Alors, plutôt que de réduire cette affaire à un simple “scandale Madani”, nous avons voulu aller plus loin.
Revenir sur ce que ce geste symbolise, sur ce qu’il révèle de nos imaginaires collectifs, et surtout, déconstruire ce biais d’adultification : comprendre comment il se forme, ce qu’il implique pour les enfants noirs — et plus encore, pour les jeunes filles noires — avant d’explorer, avec les mots d’Anaïs Alachède (sexologue et auteure) les pistes pour le réparer.
Le biais d’adultification : voir des adultes là où il y a des enfants
L’adultification, c’est ce mécanisme par lequel on projette sur les enfants noirs des caractéristiques d’adultes : force, conscience, sexualité, responsabilité.
Autrement dit, c’est nier leur innocence.
Ce biais montre que dès l’âge de cinq ans, les enfants noirs — filles comme garçons — sont perçus comme plus âgés, plus indépendants et moins vulnérables que les enfants blancs du même âge.
À l’école, cela se traduit souvent par des sanctions disciplinaires plus sévères. Un élève noir qui parle fort, qui bouge trop ou qui répond est jugé “insolent”, là où un autre sera simplement “dynamique”.
Dans la justice, ces perceptions biaisées conduisent à criminaliser plus tôt : on parle de “jeunes hommes noirs” ou de “grandes filles noires”, jamais d’enfants.
Et dans les médias, l’adultification se glisse dans les mots : quand un adolescent noir est abattu, les titres évoquent “un suspect”, “un jeune homme”, alors qu’un enfant blanc devient un “garçon”, une “fille”, une “victime”.
Ces différences de langage ne sont pas anodines : elles façonnent notre imaginaire collectif.
Elles expliquent pourquoi tant d’adultes voient une menace là où il n’y a qu’un enfant — comme dans l’affaire Nawell Madani.
Penser qu’un petit garçon de six ans puisse “voler” un sac, c’est déjà lui attribuer une intention d’adulte, une conscience morale qu’il n’a pas. C’est oublier son âge, sa taille, son innocence. Et c’est exactement cela, le cœur du problème : quand on voit un adulte à la place d’un enfant, on justifie des gestes, des peurs et des violences qui n’auraient jamais existé autrement.
L’adultification ne rend pas les enfants noirs plus forts.
Elle les rend simplement plus seuls, confrontés trop tôt à des regards qui les obligent à grandir avant l’heure.
L’affaire Nawell Madani : violence physique, violence symbolique
Dans cette affaire, l’enfant noir n’a pas eu droit à l’innocence.
Un simple geste, un mouvement perçu comme “suspect”, a suffi pour déclencher la peur, la colère, la violence.
Et c’est là que réside toute la gravité : on lui a prêté des intentions qu’il n’avait pas, une maturité qu’il n’avait pas, une dangerosité qui n’existait pas.
Ce n’est pas seulement une incompréhension, c’est un réflexe ancré dans des siècles de représentations racialisées. Voir dans un enfant noir une menace, c’est une image que la société a construite, nourrie et transmise, génération après génération.
Et trop souvent, cette image a tué.
Aux États-Unis, celui de Trayvon Martin, 17 ans, tué en 2012 par un voisin qui affirmait avoir “eu peur”.
En France, le nom de Nahel, 17 ans, tué à bout portant par un policier lors d’un contrôle routier, résonne encore.
Deux adolescents racisés, deux morts, et une même mécanique : la panique supposée, la peur irrationnelle d’un corps perçu comme “dangereux” simplement parce qu’il n’entre pas dans les codes de l’innocence blanche. Paix à leur âme. 🕊️
Ce qui s’est joué dans la scène filmée de Nawell Madani n’a pas entraîné la mort, mais il s’agit du même réflexe, du même regard biaisé : celui qui vole l’enfance noire avant même qu’elle ait le temps d’exister.
Lorsqu’un adulte frappe un enfant en pensant se défendre, c’est déjà un monde où l’empathie s’est effacée.
Et dans tout ça ?
C’est clairement le reflet d’une structure plus large, d’un conditionnement collectif où les enfants noirs sont perçus comme “responsables”, “conscients”, “maîtrisant leurs actes”.
Le biais genré : l’adultification des filles noires
L’adultification ne touche pas seulement les garçons noirs perçus comme menaçants.
Elle frappe aussi les filles noires, perçues comme trop matures, trop fortes, trop “sachantes”. Des mots qui, derrière une apparente admiration, dissimulent une injonction : celle d’être adulte avant l’heure.
Dans de nombreuses familles, cette injonction prend la forme d’un rôle silencieux : celui de la “petite maman”.
Souvent l’aînée, elle s’occupe de ses frères et sœurs, aide aux tâches domestiques, devient les yeux et les oreilles du foyer. Ce rôle, justifié par l’amour et la nécessité, lui apprend la responsabilité… mais lui retire aussi une part d’enfance.
À cela s’ajoute un regard social qui sexualise les filles noires très tôt.
Leurs corps sont jugés, commentés, parfois même hypersexualisés dès l’adolescence.
Un short devient “provocant”, un corps en pleine croissance devient “assumé”.
Cette hypervisibilité du corps noir féminin fabrique un paradoxe douloureux : elles doivent être fortes, mais pas trop visibles ; présentes, mais jamais vulnérables.
Et puis, il y a cette pression morale : celle d’être toujours bien élevée, polie, irréprochable.
On leur apprend très tôt à tout maîtriser — leur parole, leur posture, leurs émotions.
On leur dit de “faire bonne figure”, de “montrer l’exemple”, de “tenir la maison” ; autant d’attentes rarement imposées aux garçons du même âge.
Comme le rappelle Anaïs Alachède dans notre podcast :
“L’adultification empêche les jeunes filles de chercher quel est leur désir à elles, avant d’être acculées par les devoirs et les attentes parentales.”
Car c’est aussi de cela qu’il s’agit : d’un refus d’espace intérieur.
Et cette privation, souvent invisible, s’étend bien au-delà de l’enfance : elle influence les relations amoureuses, la santé mentale, le rapport au corps, jusqu’à la façon dont certaines perçoivent la maternité elle-même.
Et c’est là que la justice reproductive entre en jeu.
Parce qu’elle ne se limite pas au droit de procréer ou non : elle englobe le droit fondamental de se questionner librement sur son propre désir, qu’il soit affectif, sexuel ou relationnel.
Vouloir, ne pas vouloir, plus tard, autrement… mais pour soi, et non par devoir ou par peur.
Or, l’adultification empêche précisément cela : elle enferme les jeunes filles noires dans des rôles, des attentes et des responsabilités qui les privent de cette exploration intime. Elles apprennent à se soucier des autres avant de se demander ce qu’elles ressentent, à plaire avant de se connaître, à répondre aux devoirs avant d’écouter leurs désirs.
Garantir la justice reproductive, c’est donc redonner aux filles noires l’espace d’être des enfants, des adolescentes, des femmes libres de choisir — sans culpabilité, sans injonction, sans héritage de silence.
Le Sharenting : un autre visage de la dépossession
Dans cette même affaire, les internautes ont aussi pointé la responsabilité du père (créateur de contenu) accusé d’exposer ses enfants sur les réseaux sociaux.
Ce qu’on appelle le sharenting, c’est la surexposition d’enfants sur Internet, souvent sans leur consentement, au nom du divertissement, du storytelling ou de la visibilité.
Et cette pratique soulève une question essentielle en lien avec l’adultification :
Que reste-t-il de l’enfance quand elle devient un contenu ?
Et dans le cas présent, elle met aussi en lumière la manière dont l’enfance noire est consommée, observée, commentée.
Est-elle toujours libre ? Toujours protégée ?
Ou bien, là encore, livrée à des regards qui ne la perçoivent plus comme une zone d’innocence, mais comme un spectacle, une performance, voire un objet d’attention collective ?
Parce qu’au fond, qu’il s’agisse d’un biais social — celui qui projette la maturité sur des enfants noirs — ou d’une surexposition numérique, la conséquence reste la même :
➡️ Une enfance qui n’appartient plus tout à fait à ceux qui la vivent.
C’est une autre forme de dépossession, plus insidieuse, mais tout aussi réelle : celle du droit à la pudeur, au secret, au temps.
Et pour prolonger cette réflexion, on vous invite à (re)découvrir notre épisode du podcast Le Canapé, aux côtés de Ketsia (du collectif Féministes contre le Cyberharcèlement – vsCyber) et de la créatrice de contenu @notjustmom_ ; un échange essentiel pour comprendre comment protéger nos enfants à l’ère numérique, tout en repensant la façon dont on partage, montre et raconte l’enfance.
Reconnaître, réparer, protéger.
Face à l’adultification, la première étape, c’est la reconnaissance.
Reconnaître que ce biais existe, qu’il traverse nos familles, nos écoles, nos médias, nos réflexes.
Qu’il ne s’agit pas d’une exagération militante, mais d’un système profondément ancré dans la manière dont la société perçoit les enfants racisés — et plus encore, les filles noires.
Dans notre épisode de podcast avec Anaïs Alachède, sexologue et infirmière, on parle aussi de réparation ; Anaïs y rappelle que “comprendre ce qu’on a porté trop tôt, c’est déjà commencer à le déposer”.
Cela passe par la thérapie, la parole, la prise de conscience que ce poids n’était pas le nôtre, et par un engagement : celui de ne pas reproduire ce schéma sur les générations suivantes.
Ne pas confier aux filles ce que les adultes n’ont plus la force de porter, ne pas transformer la responsabilité en devoir, ni la force en identité.
Protéger l’enfance noire, c’est refuser qu’elle soit déformée, volée, instrumentalisée.
C’est lui rendre le droit d’être insouciante, bruyante, curieuse, maladroite — tout ce que l’enfance a de beau et de fragile.
C’est aussi ça la justice reproductive, pilier fondamental de TQJSN : le droit d’explorer son corps, ses désirs, sa liberté, sans avoir à rattraper une enfance volée.
C’est offrir aux générations qui viennent la possibilité d’être, simplement.
Pour continuer à comprendre, à guérir et à agir, retrouvez l’épisode “Trop grandes, trop tôt” avec Anaïs Alachède, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d’écoutes 🎧💜
Avant de parler de transmission, il faut parler de protection.
Partagez cet article s’il vous a plu !
Sources :